CULTURA si CIVILIZATIA FRANCEZA
Cioran
*Oeuvres*,
Edition Gallimard, France, 1995
*Sur les cimes du désespoir*
**
*
Etre
lyrique*
**
page première 19:
Pourquoi ne pouvons-nous demeurer enfermés en nous? Pourquoi
poursuivons-nous l'expression et la forme, cherchant à nous vider de tout
contenu, à organiser un processus chaotique et rebelle? Ne serait-il pas
plus fécond de nous abandonner à notre fluidité intérieure, sans souci
d'objectivation, nous bordant à jouir de tous nos bouillonnements, de toutes
nos agitations intimes? Des vécus multiples et différenciés fusionneraient
ainsi pour engendrer une effervescence des plus fécondes, semblables à un
raz de marée ou un paroxysme musical.
Etre plein de soi, non dans le sens de l'orgueil, mais de la richesse, etre
*(accent circonflexe sur e)* travaillé par une infinité intérieure et une
tension extreme, cela signifie vivre intensément, jusqu'à se sentir mourir
de vivre. Si rare est ce sentiment, et si étrange, que nous devrions le
vivre avec des cris. Je sens que je devrais mourir de vivre et me demande
s'il y a un sens à en rechercher l'explication. Lorsque le passé de l'âme
palpite en vous dans une tension infinie, lorsqu'une présence totale
actualise des expériences enfouies, qu'un rythme perd son équilibre et son
uniformité, alors la mort vous arrache des cimes de la vie, sans qu'on
éprouve devant elle cette terreur qui en accompagne la douloureuse
obsession. Sentiment analogue à celui des amants lorsque, au comble du
bonheur, surgit devant eux, fugitivement mais intensément, l'image de la
mort, ou lorsque, aux moments d'incertitude, émerge, dans un amour naissant,
la prémonition de la fin ou de l'abandon.
Trop rares sont ceux qui peuvent subir de telle expérience jusqu'au bout. Il
est toujours dangereux de contenir une énérgie explosive,car le moment peut
venir où l'on n'aura plus la force de la maîtriser. L'effondrement alors
naîtra d'un trop-plein. Il existe des états et des obsessions avec lesquels
on ne saurait vivre. Le salut ne consiste-t-il pas dès lors à les avouer?
Gardées dans la conscience, l'expérience terrible et l'obsession terrifiante
de la mort mènent à la ruine. En parlant de la mort, on a sauvé quelque
chose de soi-meme, et pourtant dans l'etre quelque chose s'est éteint.
pages dernières 1629, 1630:
* Exercices d'admiration*
**
* En relisant...*
La première version du livre fut rédigée très vite en 1947 et s'appelait ''
Exercices négatifs''. Je la montrai à un ami qui me la rendit quelque jours
après en me disant: ''Cela a besoin d'etre récrit en entier.'' Je pris très
mal son conseil mais, fort heureusement, je le suivis. En fait je l'ai écrit
quatre fois, car je ne voulais à aucun prix qu'il fut *(accent circonflex
sur u)* considéré comme le produit d'un venu d'ailleurs. Ce que
j'ambitionnais c'était ni plus ni moins que de rivaliser avec les indigènes.
D'où pouvait bien dériver pareille outrecuidance? Mes parents, qui savaient
seulement le roumain et le hongrois et un brin d'allemand, ne connaissaient
comme mots français que *bonjour *et *merci*. Tel était le cas de la
quasi-totalité des Transylvains. Quand en 1929 j'allai à Bucarest pour de
vagues études, je constatait que la plupart des intellectuels y parlaient
couramment le français: d'où chez moi, qui le lisait sans plus, une rage qui
devait durer longtemps et qui dure encore, sous une autre forme, puisque,
une fois à Paris, je n'ai jamais pu me débarraser de mon accent valaque. Si
donc je ne peux articuler comme les autochtones, du moins vais-je tenter
d'écrire comme eux, tel dut etre mon raisonnement inconscient, sinon comment
expliquer mon acharnement à vouloir faire aussi bien qu'eux et meme,
présomption insensée, mieux qu'eux?
Les efforts que nous déployons pour nous affirmer, pour nous mesurer avec
nos semblables et, si possible, pour les surclasser, ont des raisons viles,
inavouables, donc puissantes. Les résolutions nobles, au contraire, émanées
d'une volonté d'effacement, manquent inévitablement de vigueur, et nous les
abandonnons vite avec ou sans regret. Tout ce par quoi nous excellons
procède d'une source trouble et suspecte, de nos profondeurs en fait.
Il y a encore ceci: j'aurais du *(accent circonflexe sur u)* choisir
n'importe quel autre idiome, sauf le français, car je m'accorde mal avec son
air distingué, il est aux antipodes de ma nature, de mes débordements, de
mon moi véritable et mon genre de misère. Par sa rigidité, par la somme des
contraintes élégantes qu'il représente, il m'apparaît comme un exercice
d'ascèse ou plutot *(accent circonflexe sur o)* comme un mélange de camisole
de force et de salon. Or c'est précisément à cause de cette incompatibilité
que je me suis attaché à lui, au point d'exulter quand le grand savant
new-yorkais Erwin Chargaff (né, comme Paul Celan, à Czernowitz) me confia un
jour que pour lui *ne méritait d'exister que ce qui était exprimé en
français...*
Aujourd'hui que cette langue est en plein déclin, ce qui m'attriste le plus
c'est de constater que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. Et c'est
moi, rebut des Balkans, qui me désole de la voir sombrer. Eh bien, je
coulerai, inconsolable, avec elle!
pages centrales représentatives 894, 895:
* La tentation d'exister*
* Le style comme aventure*
**
* *Rompus à un art de penser purement verbal, les sophistes s'employèrent
les permiers à réfléchir sur les mots, sur leur valeur et leur propriété,
sur la fonction qui leur revenait dans la conduite du raisonnement: le pas
capital vers la découverte du style, conçu comme but en soi, comme fin
intrinsèque, était franchi. Il ne restait plus qu'à transposer cette
quete *(accent
circonflexe sur e)* verbale, à lui donner pour objet l'harmonie de la
phrase, à substituer au jeu de l'abstraction le jeu de l'expression.
L'artiste réfléchissant sur ses moyens est donc redevable au sophiste, il
lui est organiquement apparenté. L'un et l'autre poursuivent, dans des
directions différente, un meme *(accent circonflexe sur e)* genre
d'activité. Ayant cessé d'etre* (accent circonflexe sur* *e)* *nature*, ils
vivent en fonction du mot. Rien d'originel en eux: aucune attache qui les
relie aux sources de l'expérience; nulle naiveté *(trema sur i)* , nul
''sentiment''. Si le sophiste pense, il domine tellement sa pensée qu'il en
fait ce qu'il veut; comme il n'est pas entraîné par elle, il la dirige
suivant ses caprices ou ses calculs; à l'égard de son propre esprit, il se
comporte en stratège; il ne médite pas, il conçoit, selon un plan aussi
abstrait qu'artificiel, des opérations intellectuelles, ouvre des brèches
dans les concepts, tout fier d'en révéler la faiblesse ou de leur accorder
arbitrairement une solidité ou un sens. La ''réalité'', il ne s'en soucie
guère: il sait qu'elle dépend des signes qui l'expriment et dont il importe
d'etre maître.
L'artiste va, lui aussi, du mot au vécu: *l'expression* constitue la seule
expérience originelle dont il soit capable. La symétrie, l'agencement, la
perfection des opérations formelles, représentent son milieu naturel: il y
réside, il y respire. Et comme il vise à épuiser la capacité des mots, il
tend, plus qu'à l'expression, à l'expressivité. Dans l'univers fermé où il
vit, il n' échappe à la stérilité que par ce renouvellement continuel que
supose un jeu où la nuance acquiert des dimensions d'idole et où la chimie
verbale réussit des dosages inconcevables à l'art naif *(tréma sur i).* Une
activité aussi délibéré, si elle se situe aux antipodes de l'expérience,
s'approche, en revanche, des extrémités de l'intellect. Elle fait de
l'artiste qui s'y voue un sophiste de la littérature.
Dans la vie de l'esprit il arrive un moment où l'écriture, s'érigeant en
principe autonome, devient destin. C'est alors que le Verbe, tant dans les
spéculations philosophiques que dans les productions littéraires, dévoile et
sa vigueur et son néant.
Boileau,
*Oeuvres poétiques,
* Bibliothèque Larousse, rue Montparnasse -
Paris
*Art poétique*
page première du poème 173:
*Chant premier*
C'EST en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur
Pense de l'art des vers atteindre la hauteur:
S'il ne sent point du ciel l'influence secrète,
Si son astre en naissant ne l'a formé poète,
Dans son génie étroit il est toujours captif;
Pour lui Phébus est sourd, et Pégas est rétif.
O vous donc qui, brulant d'une ardeur périlleuse,
Courez du bel esprit la carrière épineuse,
N'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer,
Ni prendre pour génie un amour de rimer:
Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces,
Et consultez longtemps votre esprit et vos forces.
La nature, fertile en esprits exellents,
Sait entre les auteurs partager les talents:
L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme;
L'autre d'un trait plaisant aiguiser l'epigramme:
Malherbe d'un héros peut vanter les exploits;
Racan, chanter Philis, les bergers et les bois:
Mais souvent un esprit qui se flatte et qui s'aime
Méconnaît son génie et s'ignore soi-meme
Ainsi *tel* autrefois qu'on vit avec* Faret*
Charbonner de ses vers les murs d'un cabaret
S'en va, mal à propos, d'une voix insolente,
Chanter du peuple hébreux la fuite triomphante,
Et, poursuivant Moise au travers des déserts,
Court avec Pharaon se noyer dans les mers.
Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime,
Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime:
L'un l'autre vainement ils semble se hair;
La rime est un esclave et ne doit qu'obéir.
Lorsqu'à le bien chercher d'abord on s'évertue,
L'esprit à trouver aisément s'habitue;
----------------------------------------------------------
1.Saint-Amant, auteur du *Moise sauvé* (Boileau), v. p. 35 --
2.Nicolas Faret, né vers 1596, mort en 1646, littérateur et moraliste, un
des fondateurs de l'Académie française, auteur de l' *Honnete homme ou L'Art
de plaire à la cour*. --
page dernière du poème 202:
*Chant IV*
N'ose encor manier la trompette et la lyre,
Vous me verrez pourtant, dans ce champ glorieux,
Vous animer du moins de la voix et des yeux;
Vous offrir ces leçons que ma muse au Parnasse
Rapporta, jeune encor, du commerce d'Horace;
Seconder votre ardeur, échauffer vos esprits,
Et vous montrer de loin la couronne et le prix.
Mais aussi pardonnez, si, plein de ce beau zèle,
De tous vos pas fameux observateur fidèle,
Quelquefois du bon or je sépare le faux,
Et des auteurs grossiers j'attaque les défauts;
Censeur un fâcheux, mais souvent nécessaire,
Plus enclin à blâmer que savant à bien faire.
page centrale représentative 185:
*Chant III*
Vous donc qui, d'un beau feu pour le théâtre épris,
Venez en vers *pompeux* y diputer le prix,
Voulez-vous sur la scène étaler des ouvrages
Où tout Paris en foule apporte ses suffrages,
Et qui, toujours plus beaux, plus ils sont regardés,
Soient au bout de vingt ans encor redemandés?
Que dans tous vos discours la passion émue
Aille chercher le coeur, l'échauffe et le remue.
Si d'un beau mouvement l'agréable fureur
Souvent ne nous remplit d'une douce terreur,
Ou n'excite en notre âme une pitié *charmante*,
En vain vous étalez une scène savante:
Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir
Un spectateur toujours paresseux d'applaudir,
Et qui, des vains efforts de votre rhétorique
Justement fatigué, s'endort ou vous critique.
Le secret est d'abord de plaire et de toucher:
Inventez des ressorts qui puissent m'attacher.
Que dès les premiers vers l'action préparée
Sans peine du sujet aplanisse l'entrée.
Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer;
De ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer,
Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue,
D'un divertissement me fait une fatigue.
J'aimerais mieux encor qu'il déclinât son* nom*
Et dît: ''Je suis Oreste, ou bien Agamemnon,
Que d'aller, par un tas de confuses merveilles,
Sans rien dire à l'esprit, étourdir les oreilles:
Le sujet n'est jamais assez tot expliqué.
Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué.
Un rimeur, sans péril, delà les *Pyrénées*,
Sur la scène en un jour renferme des années:
Là souvent le héros d'un spectacle grossier,
Enfant au premier acte, est barbon au dernier.
Mais nous, que la raison à ses règles engage,
Nous voulons qu'avec art l'action se ménage;
Qu'en un lien, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théâtre* rempli*.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dans un sens favorable, *magnifique. --*
2. La terreur et la pitié sont les deux grands ressorts de l'émotion
tragique d'après Aristote. --
3. Il y a de pareils exemples dans Euripide (Boileau). --
4. Lope de Vega ou Calderon. --
5. Règle des trois unités. --
Alfred de Vigny
*Poésies complètes*,
Edition de Cluny A Paris, 1937
POEMES ANTIQUES ET MODERNES
*LIVRE MYSTIQUE*
premières pages 5, 6:
*Moise*
Le soleil prolongeait sur la cime des tentes
Ces obliques rayons, ces flammes éclatantes,
Ces larges traces d'or qu'il laisse dans les airs,
Lorsqu'en lit de sable il se couche aux déserts.
La pourpre et l'or semblait revetir la campagne.
Du stérile Nébo gravissant la montagne,
Moise, homme de Dieu, s'arrete, et, sans orgueil,
Sur le vaste horizon promène un long coup d'oeil.
Il voit d'abord Phasga, que des figuiers entourent;
Puis, au delà des monts que ses regards parcourent,
S'étend tout Galaad, Ephraim, Manassé
Dont le pays fertile à sa droite est placé;
Vers le Midi, Juda, grand et stérile, étale
Ses sables où s'endort la mer occidentale;
Plus loin, dans un vallon que le soir a pâli,
Couronné d'oliviers, se montre Nephtali;
Dans les plaines de fleurs magnifiques et calmes
Jéricho s'aperçoit, c'est la ville des palmes;
Et, prolongeant ses bois, des plaines de Phogor
Le lentisque touffu s'étend jusqu'à Ségor.
Il voit tout Chanaan et la terre promise
Où sa tombe, il le sait, ne sera point admise.
Il voit; sur les Hébreux étend sa grande main,
Puis vers le haut du mont il reprend son chemin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. *Moise* est mis en tete de toutes les éditions à partir de 1829 à cause
de l'éminente dignité du symbole. Au seuil de l'oeuvre il brave
l'avertissement qu'avec les ignorances de l'humanité commune, on perd toute
joie et que l'élection divine est une malédiction. De 1826 à 1829 le poème
fut dédié à Victor Hugo.
FRAGMENTS ET FANTAISIES OUBLIEES
dernière page 261:
*Un vers de Dante*
A Madame Ristori*
après la représentation de ''Myrrha''
Myrrha nous a pris tous dans sa large ceinture
Sanglante et dénouée. - Elle apparut ici
Comme la Passion brulant dans la Sculpture.
- Le livre de la Bible eut dit de vous ainsi:
La France s'est levée, elle vous a louée
Comme la femme forte, heureuse et dévouée,
*Fille du beau pays ou résonne le si!*
----------------------------------------------------------------
226. Allusion au vers de l'*Enfer*: ''Pise, opprobre du beau pays où résonne
le si.''
*A Jules Janin*
* Pour le jour de sa fete*
**
Merci, mon cher poète, à ton fifre charmant;
Harmonieux et tendre, il captivait mon âme,
Les flots n'ont pas noyé tes sons, et l'Océan
Ne les a pas couverts d'une oublieuse lame.
Comme un parfum de fleur, comme un aimable encens,
Ils sont montés, pieux, vers la céleste voute.
D'illustre morts suivaient tes reves et tes chants.
Béranger te souris, Chateaubriand t'écoute.
Et moi je viens, l'un des derniers,
Près de ces noms prendre ma place.
Je te couronne de lauriers
Que pour toi m'a remis Horace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
227. Publié dans le *Forez littéraire et artistique*, déc. - janv.
1888-1889. Le poème date des dernières années de Vigny.
LES DESTINEES
pages centrales représentatives 171, 172:
* Le Mont des Oliviers*
Alors il était nuit, et Jésus marchait seul,
Vetu de blanc ainsi qu'un mort de son linceul;
Les disciples dormaient au pied de la colline.
Parmi les oliviers, qu'un vent sinistre incline,
Jésus marche à grands pas en frissonant comme eux;
Triste jusqu'à la mort, l'oeil sombre et ténébreux,
Le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe
Comme un voleur de nuit cachant ce qu'il dérobe;
Connaissant les rochers mieux qu'un sentier uni,
Il s'arrete en un lieu nommé Gethsémani.
Il se courbe, à genoux, le front contre la terre;
Puis regarde le ciel en appelant: ''Mon Père!''
-Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas.
Il se lève étonné, marche encore à grand pas,
Froissant les oliviers qui tremblent. Froide et lente,
Découle de sa tete une sueur sanglante.
Il recule, il descend, il crie avec effroi:
''Ne pouviez-vous prier et veiller avec moi?''
Mais un sommeil de mort accable les apotres,
Pierre à la voix du maître est sourd comme les autres.
Le Fils de l'homme alors remonte lentement.
Comme un pasteur d'Egypte, il cherche au firmament
Si l'Ange ne luit pas au fond de quelque étoile.
Mais un nuage en deuil s'étend comme le voile
D'une veuve, et ses plis entourent le désert.
Jésus, se rappelant ce qu'il avait souffert
Depuis trente-trois ans, devint homme, et la crainte
Serra son coeur mortel d'une invincible étreinte.
Il eut froid. Vainement il appela trois fois:
''Mon Père!'' - Le vent seul répondit à sa voix.
Il tomba sur le sable assis et, dans sa peine,
Eut sur le monde et l'homme une pensée humaine.
-Et la Terre trembla, sentant la pesanteur
Du Sauveur qui tombait aux pieds du Créateur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
159. Inspiré par l'extraordinaire *Reve* de Jean-Paul: *Du haut de
l'édifice du monde le Christ mort proclame qu'il* *n'y a pas de Dieu*.
L'idée d'un Christ sceptique (qui apparaît dans le *Journal* dès 1830) est
une idée maîtresse dans le procès que Vigny mène contre création. Autre
Prométhée, le Christ n'est pas le fils de Dieu, mais un représentant du
progrès de l'humanité. (Michelet, *Hist. de France* II, 8, 1833; Strauss, *Vie
de Jésus* 1839; Pierre Leroux, *De l'Humanité* 1840.) Pour Vigny, la
''question est de réduire le Christ à la condition de mythe et à l'état de
légende en partant de cette distinction que le mythe peut etre bon à
conserver comme mythologie philosophique'' (*Journal *1839). L'attachement
de Vigny pour cette mythologie est significative. Depuis 1840, il était
tenté par l'hindouisme (Dorison, Bonnefoy) et en particulier par l'absence
de Dieu dans la pensée de Boudha. La strophe du *Silence*, ajoutée en 1862,
paraît répondre à cette tentation du silence boudhique sur Dieu et l'origine
de l'homme. Mais il reste en Vigny, quoi qu'il fasse, une imagination et
meme une sorte de piété chrétienne; il s'effraie du matérialisme et du
panthéisme où il voit un autre matérialisme. Un projet de *Maison du
Berger*porte: ''prions pour que tout soit vrai dans le
christianisme''. (Bonnefoy,
p. 317).
Ecrit de 1840 à 1844, publié dans la Revue des Deux-Mondes, le Ier juin
1844.
Rapprocher des sonnets contemporains de G. de Nerval, Le *Christ aux
Oliviers *( mars 1844).
Victor Hugo
*Notre-Dame de Paris,
1482*, Ed. Pocket, Paris, 1989
LIVRE PREMIER
I
pages premières 31,32:
*La grand'salle*
Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours
que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à
grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la
Ville.
Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6
janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle,
dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut
de picards ou de bourguignons, ni une châsse menée en procession, ni une
révolte d'écoliers dans la vigne de Laas, ni une entrée de *notredit très
redouté seigneur monsieur le roi,* ni meme une belle pendaison de larron et
de larronnesses à la Justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue,
si fréquente au quinzième siècle, de quelque ambassade chamarrée et
empanachée. Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce
genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre
le dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand
ennui de Monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait du
faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et
les régaler, en son hotel de Bourbon, d'une* moult belle moralité, sotie et
farce*, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques
tapisseries.
Le 6 janvier, ce qui *mettait en émotion tout le populaire de Paris*,
comme dit Jehan de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un
temps immémorial, du jour des Rois et de la Fete des Fous.
LIVRE ONZIEME
IV
dernières pages 592, 593:
*Mariage de Quasimodo*
A la fin du quinzième siècle, le formidable gibet, qui datait de 1328,
était déjà fort décrépit. Les poutres étaient vermoulues, les chaînes
rouillées, les piliers verts de moisissure. Les assises de pierre de taille
étaient toutes refendues à leur jointure, et l'herbe poussait sur cette
platforme où les pieds ne touchaient pas. C'était un horrible profil sur le
ciel que celui de ce monument; la nuit surtout, quand il y avait un peu de
lune sur ces crânes blancs, ou quand la bise du soir froissait chaînes et
squelettes et remuait tout cela dans l'ombre. Il suffisait de ce gibet
présent là pour faire de tous les environs des lieux sinistres.
Le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice était creux. On
y avait pratiqué une vaste cave, fermée d'une vieille grille de fer
détraquée, où l'on jetait non seulement les débris humains qui se
détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les malheureux
exécutés aux autres gibets permanents de Paris. Dans ce profond charnier où
tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble, bien des
grands du monde, bien des innocents sont venus successivement apporter leurs
os, depuis Enguerrand de Marigni, qui étrenna Mont-faucon et qui était un
juste, jusqu'à l'amiral de Coligni, qui en fit la cloture et qui était un
juste.
Quand à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous
avons pu découvrir.
Deux ans environ ou dix-huit mois après les événements qui terminent cette
histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre
d'Olivier le Daim, qui avait été pendu deux jours auparavant, et à qui
Charles VIII accordait la grâce d'etre enterré à Saint-Laurent en meilleure
compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses deux squelettes
dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces deux
squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelque lambeaux de
robe d'une étoffe qui avait été blanche, et on voyait autour de son cou un
collier de grains d'adrézarach avec un petit sachet de soie, orné de
verroterie verte, qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de
valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait
celui -ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua
qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tete dans les omoplates, et une
jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de
vertèbre, à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu.
L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort.
Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait, il tomba en
poussière.
LIVRE CINQUIEME
II
pages centrales représentatives 235, 236:
*Ceci tuera cela*
Et désormais, si l'architecture se relève accidentellement, elle ne sera
plus maîtresse. Elle subira la loi de la littérature qui la recevait d'elle
autrefois. Les positions respectives des deux arts seront interverties. Il
est certain que dans l'époque architecturale les poèmes, rares, il est vrai,
ressemblent aux monuments. Dans l'Inde, Vyasa est touffu, étrange,
impénétrable comme une pagode. Dans l'orient égyptien, la poésie a, comme
édifice, la grandeur et la tranquillité des lignes; dans la Grèce antique,
la beauté, la sérénité, le calme; dans l'Europe chrétienne, la majesté
catholique, la naiveté populaire, la riche et luxuriante végétation d'une
époque de renouvellement. La Bible ressemble aux Pyramides, l'Iliade au
Parthéon, Homère à Phidas. Dante au treizième siècle, c'est la dernière
église romane; Shakespeare au seizième, la dernière cathédrale gothique.
Ainsi, pour résumer ce que nous avons dit jusqu'ici d'une façon
nécessairement incomplète et tronquée, le genre humain a deux livres, deux
registres, deux testaments, la maçonnerie et l'imprimerie, la bible de
pierre et la bible de papier. Sans doute, quand on contemple ces deux bibles
si largement ouvertes dans les siècles, il est permis de regretter la
majesté visible de l'écriture de granit, ces gigantesques alphabets formulés
en colonnades, en pylones, en obélisques, ces espèces de montagnes humaines
qui couvrent le monde et le passé depuis la pyramide jusqu'au clocher, de
Chéops à Strasbourg. Il faut admirer et refeuilleter sans cesse le livre
écrit par l'architecture; mais il ne faut pas nier la grandeur de l'édifice
qu'élève à son tour l'imprimerie.
Cet édifice est colossal. Je ne sais quel faiseur de statistique a calculé
qu'en superposant l'un à l'autre tous les volumes sortis de la presse depuis
Gutenberg on comblerait l'intervalle de la terre à la lune; mais ce n'est
pas de cette sorte de grandeur que nous voulons parler. Cependant, quand on
cherche à recueillir dans sa pensée une image totale de l'ensemble des
produits de l'imprimerie jusqu'à nos jours, cet ensemble ne nous apparaît-il
pas comme une immense construction, appuyée sur le monde entier, à laquelle
l'humanité travaille sans relâche, et dont la tete monstrueuse se perd dans
les brumes profondes de l'avenir? C'est la fourmilière des intelligences.
C'est la ruche où toutes les imaginations, ces abeilles dorées, arrivent
avec leur miel. L'édifice a mille étages
Pierre de Ronsard
*Les Amours*,
Editions Jean-Claude Lattès, Paris, 1995
*LES AMOURS*
1552-1553
premières pages, 9, 10:
*Voeu*
Divin troupeau, qui sur les rives molles
Du fleuve Eurote, ou sur le mont natal,
Ou sur le bord du chevalin crystal,
Assis, tenez vos plus sainctes escolles:
Si quelque foys aux saultz de vos carolles
M'avez receu par ung astre fatal,
Plus dur qu'un fer, qu'en cuyvre ou qu'en metal,
Dans vostre temple engravez ces paroles:
RONSARD, AFFIN QUE LE SIECLE A VENIR,
DE PERE EN FILZ SE PUISSE SOUVENIR,
D'UNE BEAUTE QUI SAGEMENT AFFOLE,
DE LA MAIN DEXTRE APPEND A NOSTRE AUTEL,
L'HUMBLE DISCOURS DE SON LIVRE IMMORTEL,
SON CUOEUR DE L'AUTRE, AUX PIEDZ DE CESTE IDOLE.
*POUR HELENE DE SURGERES*
dernières pages 381, 382:
Maistresse, embrasse moy, baize moy, serre moy,
Haleine contre haleine, échauffe moy la vie,
Mille & mille baizers donne moy je te prie,
Amour veut tout sans nombre, amour n'a point de loy.
Baize & rebaize moy; belle bouche pourquoy
Te gardes tu là bas, quand tu seras blesmie,
A baiser (de Pluton ou la femme ou l'amie),
N'ayant plus ny couleur, ny rien semblable à toy?
En vivant presse moy de tes levres de roses,
Begaye, en me baisant, à levres demy-closes
Mille mots traçonnez, mourant entre mes bras.
Je mourray dans les tiens, puis, toy resuscitee,
Je resusciteray, allons ainsi là bas,
Le jour tant soit il court vaut mieux que la nuitee.
*LES AMOURS*
page centrale représentative 183:
* 183*
**
Son chef est d'or, son front est un tableau
Où je voy peint le gaing de mon dommage,
Belle est sa main, qui me fait devant l'age,
Changer de teint, de cheveulx, & de peau.
Belle est sa bouche, & son soleil jumeau,
De neige & feu s'embellit son visage,
Pour qui Juppin reprendroyt le plumage,
Ore d'un Cygne, or le poyl d'un toreau.
Doulx est son ris, que la Meduse mesme
Endurciroyt en quelque roche blesme,
Vangeant d'un coup cent mille cruaultez.
Mais tout ainsi que le Soleil efface
Les moindres feux: ainsi ma foy surpasse
Le plus parfaict de toutes ses beaultez
Antoine de Saint- Exupéry
*Citadela*,
Ed. Rao, 1993
I
*paginile 5,6:*
De prea multe ori am văzut mila rătăcindu-se. Noi însă, cei ce guvernăm
oamenii, am învăţat să privim în inimile lor şi să nu acordăm grija noastră
decât celor demni de atenţie. Refuz să am milă faţă de rănile ostentative ce
frământă inimile femeilor, aşa cum o refuz morţilor şi muribunzilor - şi
ştiu pentru ce.
A fost o vreme, în tinereţea mea, când îmi era milă de cerşetori şi de
rănile lor, când plăteam pentru ei tămăduitori şi cumpăram leacuri -
caravanele îmi aduceau dintr-o insulă unguente cu amestec de aur, care
refăceau pielea deasupra rănii deschise. Am făcut aceasta până în ziua în
care am înţeles că ţineau la duhoarea lor ca la un lux rar, căci i-am
surprins zgâriindu-se şi mânjindu-se cu bălegar, asemenea acelora care
îngraşă pământul pentru a-i extrage seva întreagă. Îşi arătau cu mândrie
unul altuia putreziciunea, fălindu-se cu ofrandele primite, fiindcă cel ce
câştiga cel mai mult egala în propprii-i ochi pe marele preot care slujeşte
celui mai frumos idol. Nu primeau să-l consulte pe medicul meu decât în
speranţa că şancrul lor îl va surprinde prin pestilenţa şi dimensiunile lui
şi-şi agitau ciotul ca pentru a ocupa mai mult loc în lume. Şi-şi primeau
îngrijirile ca pe un omagiu, oferindu-şi membrele abluţiunilor care-i
flatau; de îndată însă ce răul era vindecat, se regăseau lipsiţi de
importanţă, nemaihrănind nimic din ei înşişi,inutili, şi se încercau să
reînvie acel ulcer care trăia în ei.
Împodobiţi din nou cu putreziciunea lor, mândri şi găunoşi, reluau drumul
caravanelor cu talgerul în mână, cerşind în numele dumnezeului lor murdar.
A fost o vreme, de asemenea, când îmi era milă de morţi, credeam că acela
pe care-l sacrificam în deşert se cufunda într-o singurătate pentru cei ce
mor. Am văzut însă egoistul sau avarul, cel care striga atât de tare
împotriva oricărei spolieri, trăindu-şi ultimele clipe şi rugând să fie
strânşi în jurul lui obişnuiţii casei, împărţindu-şi bunurile sale cu o
echitate dispreţuitoare, aşa cum împarţi unor copii jucării inutile.
Am văzut rănitul bicisnic, cel care ar fi urlat după ajutor în preajma
unui pericol fără importanţă, pentru ca apoi, într-adevăr lovit fără
speranţă, să respingă din partea celorlalţi orice asistenţă, dacă i se părea
că aceasta i-ar fi pus pe tovarăşii săi în pericol.
*paginile 430, 431,432:*
**
Unora, ca şi celorlalţi, nu le cer să mă iubească, şi puţin îmi pasă dacă mă
ignoră sau mă urăsc, cu condiţia ca ei să mă respecte ca drum către tine,
fiindcă iubirea eu nu o cer decât pentru tine, căci ei îţi aparţin - şi eu
îţi aparţin - legând snopul mişcărilor lor de adoraţie şi dăruindu-le ţie,
aşa cum eu dăruiesc imperiului, şi nu mie, veghea santinelei mele, căci eu
nu sunt zid, ci sămânţă care din pământ îşi extrage ramurile ce-o vor înălţa
spre soare.
Simt câteodată, fiindcă pentru mine nu există rege, care să mă poată
răsplăti cu un surâs, şi trebuie să aştept ora când vei binevoi să mă
primeşti şi să mă contopeşti cu cei ce aparţin iubirii mele, simt, deci,
oboseala de a fi singur şi dorinţa de a mă alătura oamenilor poporului meu,
căci, fără îndoială, nu sunt încă îndeajuns de pur.
Văzându-l fericit pe grădinarul ce se destăinuie prietenului său, simt
câteodată dorinţa să mă leg astfel, în divinitatea lor, de grădinarii
imperiului meu. Şi mi se întâmplă să cobor cu paşi uşori, puţin înaintea
zorilor, treptele palatului meu, către grădină. Merg înspre tufele de
trandafiri. Mă aplec atent asupra vreunei tulpini, eu, care la prânz voi
hotărî asupra iertării sau morţii, asupra păcii sau războiuluil. Asupra
supravieţuirii sau distrugerii imperiilor. Apoi, ridicându-mă cu efort, căci
am început să îmbătrânesc, spun cu simplitate, în inima mea, pentru a mă
alătura, prin singura cale posibilă tuturor grădinarilor vii şi morţi: *Şi
eu, în această dimineaţă, mi-am curăţat trandafirii.* Şi puţin contează dacă
acest mesaj călătoreşte sau nu ani întregi, dacă ajunge sau nu la unul sau
altul. Căci nu acesta este obiectul mesajului. Pentru a mă alătura
grădinarilor mei, am închinat în în faţa divinităţii lor un trandafir în
zorii zilei.
Doamne, duşmanul meu iubit nu mă voi alătura decât dincolo de mine însumi.
Şi pentru el, fiindcă îmi seamănă, este adevărat acest lucru. Eu împart
dreptatea după înţelepciunea mea. El împarte dreptatea după înţelepciunea
lui. Ele par contradictorii şi, dacă se înfruntă, sunt hrană pentru
războaiele noastre. Dar şi el şi eu, pe drumuri opuse, urmăm, în palmele
noastre, liniile de forţă ale aceluiaşi foc. Şi doar în tine, Doamne, ele se
vor regăsi.
Eu am înfrumuseţat, deci, o dată ce mi-am dus munca la bun sf'ârşit,
sufletul poporului său. Iar eu, care mă gândesc la el, şi el, care se
gândeşte la mine, deşi nici un limbaj nu ne este oferit pentru a ne putea
întâlni, atunci când am pronunţat o sentinţă sau am dictat un ceremonial,
când am pedepsit sau iertat, putem spune, el pentru mine, iar eu
pentru el:*În această dimineaţă mi-am curăţat trandafirii...
*
* *Căci tu eşti, Doamne, măsura comună a unuia şi a celuilalt. Tu eşti
nodul esenţial al actelor diverse
Albert Camus
* *L' Eté,
*Ed. Gallimard, Paris, 1954,
*page13:*
Il n'y a plus de déserts. Il n'y a plus d'îles. Le besoin pourtant s'en
fait sentir. Pour comprendre le monde, il faut parfois se détourner; pour
mieux servir les hommes, les tenir un moment à distance. Mais où trouver la
solitude nécessaire à la force, la longue respiration où l'esprit se
rassemble et le courage se mesure? Il reste les grandes villes. Simplement,
il faut encore des conditions. Les villes que l'Europe nous offre sont
pleines des rumeurs du passé. Une oreille exercée peut y percevoir des
bruits d'ailes, une palpitation d'âme.
*page188:*
**
* *A minuit, seul sur le rivage. Attendre encore, et je partirai. Le ciel
lui meme est en panne, avec toutes ses étoiles, comme ces paquebots couverts
de feux qui, à cette heure meme, dans le monde entier, illuminent les eaux
sombres des ports. L'espace et le silence pèsent d'un seul poids sur le
coeur. Un brusque amour, une grande oeuvre, un acte décisif, une pensée qui
transfigure, à certains moments donnent la meme intolérable anxiété, doublée
d'un attrait irrésistible. Délicieuse angoisse d'etre, proximité exquise
d'un danger dont nous ne connaissons pas le nom, vivre, alors, est-ce courir
à sa perte? A nouveau, sans répit, courons à notre perte.
J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé, au coeur d'un
bonheur royal.
**
*page 93:*
**
* *La douceur d'Alger est plutot italienne. L'état cruel d'Oran a quelque
chose d'espagnol. Perchée sur un rocher au-dessus des gorges du Rummel,
Constantine fait penser à Tolède. Mais l'Espagne et l'Italie regorgent de
souvenirs, d'oeuvres d'art et de vestiges exemplaires. Mais Tolède a eu son
Gréco et son Barrès. Les cités dont je parle au contraire sont des villes
sans passé. Ce sont des villes sans abandon, et sans attendrissement. Aux
heures d'ennui qui sont celles de la sieste, la tristesse y est implacable
et sans mélancolie
Albert Camus
*La Peste*
Ed. Gallimard, Paris, 1947
*pages 13, 14:*
Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont
produits en I94., à Oran. De l'avis général, ils n'y étaient pas à leur
place, sortant un peu de l'ordinaire. A première vue, Oran est, en effet,
une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la cote
algérienne.
La cité elle-meme, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il
faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant
d'autre villes commerçantes, sous toutes latitudes. Comment faire imaginer,
par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l'on ne
rencontre ni battements d'ailes ni froissements de feuilles, un lieu neutre
pour tout dire? Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le
printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles
de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues; c'est un printemps
qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons
trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise; on ne peut plus vivre
alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est, au contraire, un
déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.
Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher
comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre
petite ville, est-ce l'effet du climat, tout cela se fait ensemble, du meme
air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y
applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais
toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils
s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires.
Naturellement, ils ont du gout aussi pour les joies simples, ils aiment les
femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils
réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les
autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent.
*pages 330,331,332:*
Mais c'est comme ça. Les autres disent: " C'est la peste, on a eu la
peste." Pour un peu, ils demanderaient à etre décorés. Mais qu'est-ce que ça
veut dire, la peste? C'est la vie, et voilà tout.
-Faites vos fumigations régulièrement.
-Oh! ne craignez rien. J'en ai encore pour longtemps et je les verrai tous
mourir. Je sais vivre, moi.
Des hurlements de joie lui répondirent au loin. Le docteur s'arreta au
milieu de la chambre.
-Cela vous ennuierait-il que j'aille sur la terrasse?
-Oh non! Vous voulez les voir de là-haut, hein?
A votre aise. Mais ils sont bien toujours les memes.
Rieux se dirigea vers l'escalier.
-Dites, docteur, c'est vrai qu'ils vont construire un monument aux morts
de la peste?
-Le journal le dit. Une stèle ou une plaque.
-J'en était sur. Et il y aura des discours.
Le vieux riait d'un rire étranglé.
-Je les entends d'ici: "Nos morts...", et ils iront casser la croute.
Rieux montait déjà l'escalier. Le grand ciel froid scintillait au-dessus
des maisons et, près des collines,les étoiles durcissaient comme des silex.
Cette nuit n'était pas si différente de celle où Tarrou et lui étaient venus
sur cette terrasse pour oublier la peste. La mer était seulement plus
bruyante qu'alors, au pied des falaises. L'air était immobile et léger,
délester des souffles salés qu'apportait le vent de l'automne. La rumeur de
la ville, cependant, battait toujours le pied des terrasses avec un bruit de
vagues. Mais cette nuit était celle de la délivrance, et non de la révolte.
Au loin, un noir rougeoiment indiquait l'emplacement des boulevards et des
places illuminées. Dans la nuit maintenant libéré, le désir devenait sans
entraves et c'était son grondement qui parvenait jusqu'à Rieux.
Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances
officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation.
Cottard, Tarrou, ceux et celle que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts
ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient
toujours les memes. Mais c'etait leur force et leur innocence et c'est ici
que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu
des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient
longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes
multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux
décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas etre de ceux
qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du
moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avaient été
faites, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il
y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait etre celle de la
victoire définitive. Elle ne pouvait etre que le témoignage de ce qu'il
avait fallu accomplir et que, sans doute, devraient accomplir encore, contre
la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements personnels,
tous les hommes qui, ne pouvant etre des saints et refusant d'admettre les
fléaux, s'efforcent cependant d'etre des médecins.
Ecoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux
se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce
que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le
bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester
pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il
attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et
les paperasses, et que, peut-etre, le jour viendrait où, pour le malheur et
l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait
mourir dans une cité heureuse
Marcel Proust
A la recherche du temps perdu*,
Editions Gallimard, 1999,
pour la présente édition en un volume.
*DU COTE DE CHEZ SWAN*
**
* A monsieur Gaston Calmette*
*Comme un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance.*
*Marcel Proust*
*Première partie*
*Combray*
**
I
..........................
pages 13, 14, premières pages:
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie
éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me
dire: ''Je m'endors.'' Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps
de chercher le sommeil m'éveillait; je voulais poser le volume que je
croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière; je n'avais pas
cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais
ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier; il me semblait que
j'étais moi-meme ce dont parlait l'ouvrage: une église, un quatuor, la
rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait
pendant quelques secondes à mon réveil; elle ne choquait pas ma raison mais
pesait comme des écailles sur mes yeux et les empechait de se rendre compte
que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à devenir
inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d'une existence
antérieure; le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y
appliquer ou non; aussitot je recouvrait la vue et j'étais bien étonné de
trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais
peut-etre plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une
chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me
demandais quelle heure il pouvait etre; j'entendais le sifflement des trains
qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d'un oiseau dans une foret,
relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le
voyageur se hâte vers la station prochaine; et le petit chemin qu'il suit va
etre gravé dans son souvenir par l'exitation qu'il doit à des lieux
nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous
la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la
douceur procaine du retour.
J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui,
pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une
allumette pour regarder ma montre. Bientot minuit. C'est l'instant où le
malade, qui a été obligé de partir en voyage et a du coucher dans un hotel
inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une
raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin! Dans un moment les
domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours.
L'espérance d'etre soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement il
a cru entendre des pas; les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie
de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit; on vient d'éteindre
le gaz; le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à
souffrir sans remède.
*Le temps retrouvé*
page 2401, dernière page:
J'éprouvait un sentiment de fatigue et d'effroi à sentir que tout ce temps
si long non seulement avait, sans une interruption, été vécu, pensé, sécrété
par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-meme, mais encore que j'avais à
toute minute à le mentenir attaché à moi, qu'il me supportait, moi, juché à
son sommet vertigineux, que je ne pouvait me mouvoir sans le déplacer comme
je le pouvait avec lui. La date à laquelle j'entendais le bruit de la
sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un
point de repère dans cette dimension énorme que je ne me savais pas avoir.
J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si
j'avais des lieues de hauteur, tant d'années.
Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré
en le regardant assis sur une chaise, combien il avait pu vieilli bien qu'il
eut tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était
levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes
flageolantes comme celles de ces vieux archeveques sur lesquels il n'y a de
solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent des jeunes
séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une
feuille, sur le sommet peu praticable de quatre-vingt-trois années, comme si
les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse,
parfois plus haute que des clochers, finissant par leur rendre la marche
difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombaient. (Etait-ce
pour cela que la figure des hommes d'un certain âge était, aux yeux du plus
ignorant, si impossible à confondre avec celle d'un jeune homme et
n'apparaissait qu'à travers le sérieux d'une espèce de nuage?) Je
m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas, il ne me
semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à
moi ce passé qui descendait déjà si loin. Aussi, si elle m'était laissée
assez longtemps pour accomplir mon oeuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y
décrire les hommes, cela dut-il les faire ressembler à des etres monstrueux,
comme occupant une place si considérable, à coté de celle si restrainte qui
leur est réservé dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure
puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années
à des époques, vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours
sont venus se placer - dans le Temps.
*Sodome et Gomorrhe, Chapitre II*
pages centrales représentatives: 1386, 1387:
Tranquillisé par mon explication avec Albertine je recommençai à vivre
davantage auprès de ma mère. Elle aimait à me parler doucement du temps où
ma grand-mère était plus jeune. Craignant que je ne me fisse des reproches
sur les tristesses dont j'avais pu assombrir la fin de cette vie, elle
revenait volontiers aux années où mes premières études avaient causé à ma
grand-mère des satisfactions que jusqu'ici on m'avait toujours cachées. Nous
reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas du moins je lisait et qu'à
Balbec je devrait bien faire de meme, si je ne travaillais pas. Je répondit
que pour m'entourer justement des souvenirs de Combray et des jolies
assiettes peintes j'aimerais relire *Les Mille et Une Nuits*. Comme jadis à
Combray quand elle me donnait des livres pour ma fete, c'est en cachette,
pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois *Les Mille et
Une Nuits* de Galland et *Les Mille Nuits et Une Nuit *de Mardrus. Mais
après avoir jeté un coup d'oeil sur les deux traductions, ma mère aurait
bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland, tout en craignant de
m'influencer à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle,
de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée, et du
sentiment qu'étant une femme, d'une part elle manquait, croyait-elle, de la
compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part elle ne devait pas juger
d'après ce qui la choquait les lectures d'un jeune homme. En tombant sur
certains contes elle avait été révolté par l'immoralité du sujet et la
crudité de l'expression. Mais surtout, conservant précieusement comme des
reliques, non pas seulement la broche, l'en-tout-cas, le manteau, le volume
de Mme de Sévigné, mais aussi les habitudes de pensée et de langage de sa
mère, cherchant en toute occasion quelle opinion celle-ci eut émise, ma
mère, pouvait douter de la condamnation que ma grand-mère eut prononcée
contre le livre de Mardrus. Elle se rappelait qu'à Combray tandis qu'avant
de partir marcher du coté de Méséglise, je lisait Augustin Thierry, ma
grand-mère, contente de mes lectures, de mes promenades, s'indignait
pourtant de voir celui dont le nom restait attaché à cet hémistiche: ''Puis
règne Mérovée'' appelé Merowig, refusait de dire Carolingines pour les
Carlovingiens auxquels elle restait fidèle. Enfin je lui avais raconté ce
que ma grand-mère avait pensé des noms grecs que Bloch, d'après Leconte de
Lisle, donnait aux dieux d'Homère, allant meme, pour les choses les plus
simples, à se faire un devoir religieux en lequel il croyait que consistait
le talent littéraire, d'adopter une orthographe greque. Ayant par exemple à
dire dans une lettre que le vin qu'on buvait chez lui était un vrai nectar,
il écrivait un vrai nektar, avec un *k,* ce qui lui permettait de ricaner au
nom de Lamartine. Or si une *Odyssée* d'où était absents les noms d' Ulysse
et de Minerve n'était plus pour elle l'*Odyssée*, qu'aurait-elle dit en
voyant déjà déformé sur la couverture le titre de ses *Mille et une Nuits*,
en ne retrouvant plus, exactement transcrits comme elle avait été de tout
temps habituée à les dire, les noms immortellement familiers de Shéhérazade,
de Dinarzade, où débaptisés eux-memes, si l'on ose employer le nom pour des
contes musulmans, le charmant Calife et les puissants Génies se
reconnaissaient à peine, étant appelés l'un le ''Kalifat'' les autres les
''Gennis'' ? Pourtant ma mère me remit les deux ouvrages et je lui dis que
je les lirait les jours où je serait trop fatigué pour me promener
Paul Verlaine
*Poèmes saturniens*,
EDDL, France, 1996
première page:
A Eugène Carrière
*Les Sages d'autrefois, qui valaient bien ceux-ci,*
*Crurent, et c'est un point encor mal éclairci,*
*Lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres,*
*Et que chaque âme était liée à l'un des astres.*
*( On a beaucoup raillé, sans penser que souvent*
*Le rire est ridicule autant que décevant,*
*Cette explication du mystère nocturne.)*
*Or ceux-là qui sont nés sous le signe SATURNE,*
*Fauve planète, chère aux nécromanciens,*
*Ont entre tous, d'après les grimoires anciens,*
*Bonne part de malheur et bonne part de bile.*
*L'Imagination, inquiète et débile,*
*Vient rendre nul en eux l'effort de la Raison.*
*Dans leurs veines le sang, subtil comme un poison,*
*Brulant comme une lave, et rare, coule et roule*
*En grésillant leur triste Idéal qui s'écroule.*
*Tels les Saturniens doivent souffrir et tels*
*Mourir, - en admettant que nous soyons mortels, -*
*Leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne *
*Par la logique d'une Influence maligne.*
* *P.
V.
dernières pages 81,82, 83,84,85:
EPILOGUE
I
Le soleil, moins ardent, luit clair au ciel moins dense.
Balancés par un vent automnal et berceur,
Les rosiers du jardin s'inclinent en cadence.
L'atmosphère ambiante a des baisers de soeur.
La Nature a quitté pour cette fois son trone
De splendeur, d'ironie et de sérénité:
Clémente, elle descend, par l'ampleur de l'air jaune,
Vers l'homme, son sujet pervers et révolté.
Du pan de son manteau, que l'abîme constelle,
Elle daigne essuyer les moiteurs de nos fronts,
Et son âme éternelle et sa force immortelle
Donnent calme et vigueur à nos coeurs mous et prompts.
Le frais balancement des ramures chenues,
L'horizon élargi plein de vagues chansons,
Tout, jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nues,
Tout, aujourd'hui, console et délivre. - Pensons.
II
Donc, c'en est fait. Ce livre est clos. Chères Idées
Qui rayiez mon ciel gris de vos ailes de feu
Dont le vent caressait mes tempes obsédées,
Vou pouvez revoler devers l' Infini bleu!
Et toi, Vers qui tintais, et toi, Rime sonore,
Et vous, Rhythmes chanteurs, et vous, délicieux
Ressouvenirs, et vous, Reves, et vous encore,
Images qu'évoquaient mes désirs anxieux,
Il faut nous séparer. Jusqu'aux jours plus propices
Où nous réunira l'Art, notre maître, adieu,
Adieu, doux compagnons, adieu, charmants complices!
Vous pouvez revoler devers l'Infini bleu.
Aussi bien, nous avons fourni notre carrière,
Et le jeune étalon de notre bon plaisir,
Tout affolé qu'il est de sa course première,
A besoin d'un peu d'ombre et de quelque loisir.
- Car toujours nous t'avons fixée, o Poésie,
Notre astre unique et notre unique passion,
T'ayant seule pour guide et compagne choisie,
Mère, et nous méfiant de l'Inspiration.
III
Ah! l'Inspiration superbe et souveraine,
L'Egérie aux regards lumineux et profonds,
Le Genium commode et l'Erato soudaine,
L'Ange des vieux tableaux avec des ors au fond,
La Muse, dont la voix est puissante sans doute,
Puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux,
Comme ces pissenlits dont s'émaillent la route,
Pousser tout un jardin de poèmes nouveaux,
La Colombe, le Saint-Esprit, le Saint Délire,
Les Troubles opportuns, les Transports complaisants,
Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre,
Ah! l'Inspiration, on l'évoque à seize ans!
Ce qu'il nous faut à nous, les Supremes Poètes
Qui vénérons les Dieux et qui n'y croyons pas,
A nous dont nul rayon n'auréola les tetes,
Dont nulle Béatrix n'a dirigé les pas,
A nous qui ciselons les mots comme des coupes
Et qui faisons des vers émus très froidement,
A nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes
Harmonieux au bord des *lacs* et nous pâmant,
Ce qu'il nous faut, à nous, c'est, aux lueurs des lampes,
La science conquise et le sommeil dompté,
C'est le front dans les mains du vieux Faust des estampes,
C'est l'Obstination et c'est la Volonté!
C'est la Volonté sainte, absolue, éternelle,
Cramponnée au projet comme un noble condor
Aux flancs fumants de peur d'un buffle, et d'un coup d'aile
Emportant son trophée à travers les cieux d'or!
Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans treve,
C'est l'effort inoui, le combat nonpareil,
C'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève
Lentement, lentement, l'Oeuvre, ainsi qu'un soleil!
Libre à nos Inspirés, coeurs qu'une oeillade enflamme,
D'abandonner leur etre aux vents comme un bouleau;
Pauvres gens! l'Art n'est pas d'éparpiller son âme:
Est-elle en marbre, ou non, la Vénus de Milo?
Nous donc, sculptons avec le ciseau des Pensées
Le bloc vierge du Beau, Paros immaculé,
Et faisons-en surgir sous nos mains empressées
Quelque pure statue au péplos étoilé,
Afin qu'un jour, frappant de ratons gris et roses
Le chef-d'oeuvre serein, comme un nouveau Memnon,
L'Aube-Postérité, fille des Temps moroses,
Fasse dans l'air futur retentir notre nom!
*Paysages tristes*
**
* A Catulle Mendès*
page centrale représentative 39:
* *V
*Chanson d'automne*
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et bleme, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte
J.-J. Rousseau
*Emile ou De L'Education*
Bibliothèque Larousse, 1927
*page 21:*
**
* *Nous naissons faibles, nous avons besoin de force; nous naissons
dépourvus de tout, nous avons besoin d'assistance; nous naissons stupides,
nous avons besoin de jugement.Tout ce que nous n'avons pas à notre
naissance, et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par
l'éducation.
Cette éducation nous vient de la nature, ou des hommes ou des choses. Le
développement interne de nos facultés et de nos organes est l'éducation de
la nature; l'usage qu'on nous apprend à faire de ce développement est
l'éducation des hommes; et l'aquis de notre expérience sur les objets qui
nous affectent est l'éducation des choses.
Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres. Le disciple
dans lequel leurs diverses leçons se contrarient est mal élevé, et ne sera
jamais d'accord avec lui-meme: celui dans lequel elles tombent toutes sur
les memes points, et tendent aux memes fins, va seul à son but et vit
conséquemment. Celui-là seul est bien élevé.
Or, de ces trois éducations différentes, celle de la nature ne dépend
point de nous; celle des choses n'en dépend qu'à certains égards. Celle des
hommes est la seule dont nous soyons vraiment les maîtres: encore ne le
sommes-nous que par supposition; car qui est-ce qui peut espérer de diriger
entièrement les discours et les actions de tous ceux qui environnent un
enfant?
Sitot donc que l'éducation est un art, il est presque impossible qu'elle
réussisse, puisque le concours nécessaire à son succès ne dépend de
personne. Tout ce qu'on peut faire à force de soins est d'approcher plus ou
moins du but, mais il faut du bonheur pour l'atteindre.
Quel est ce but? c'est celui meme de la nature; cela vient d'etre prouvé.
Puisque le concours des trois éducations est nécessaire à leur perfection,
c'est sur celle à laquelle nous ne pouvons rien qu'il faut diriger les deux
autres. Mais peut-etre ce mot de nature a-t-il un sens trop vague; il faut
tâcher ici de le fixer.
La nature, nous dit-on, n'est que l'habitude. Que signifie cela ? N'y
a-t-il pas des habitudes qu'on ne contracte que par force, et qui
n'étouffent jamais la nature ? Telle est, par exemple, l'habitude des
plantes dont on gene la direction verticale. La plante mise en liberté garde
l'inclination qu'on l'a forcée à prendre; mais la sève n'a point changé pour
cela sa direction primitive, et, si la plante continue à végéter, son
prolongement redevient vertical. Il en est de meme des inclinaisons des
hommes....L'éducation n'est certainement qu'une habitude.
*pages 196, 199:*
**
Dès qu'une fois il est démontré que l'homme et la femme ne sont ni ne
doivent etre constitué de meme, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit
qu'ils ne doivent pas avoir la meme éducation. En suivant les directions de
la nature, ils doivent agir de concert, mais ils ne doivent pas faire les
memes choses; la fin des travaux est commune, mais les travaux sont
différents, et par conséquent les gouts qui les dirigent. Après avoir tâché
de former l'homme naturel, pour ne pas laisser imparfait notre ouvrage,
voyons comment doit se former aussi la femme qui convient à cet homme.
Voulez-vous toujours etre bien guidé, suivez toujours les indications de
la nature. Tout ce qui caractérise le sexe doit etre respecté comme établi
par elle. Vous dites sans cesse: les femmes ont tel et tel défaut que nous
n'avons pas. Votre orgueil vous trompe, ce serait des défauts pour vous, ce
sont des qualités pour elles; tout irait moins bien si elles ne les avaient
pas. Empechez ces prétendus défauts de dégénérer mais gardez-vous de les
détruire.
Les femmes, de leur coté, ne cessent de crier que nous les élevons pour
etre vaines et coquettes, que nous les amusons sans cesse à des puérilités
pour rester plus facilement les maîtres; elles s'en prennent à nous des
défauts que nous leur reprochons. Quelle folie! Et depuis quand sont-ce les
hommes qui se melent de l'éducation des filles? Qui est-ce qui empeche les
mères de les élever comme il leur plaît? Elles n'ont point de collège: grand
malheur! Eh! plut à Dieu qu'il n'y en eut point pour les garçons! ils
seraient plus sensément et plus honnetement élevés....De la bonne
constitution des mères dépend d'abord celle des enfants: du soin des femmes
dépendent encore leurs moeurs, leurs passions, leurs gouts, leurs plaisirs,
leur bonheur meme. Ainsi toute l'éducation des femmes doit etre relative aux
hommes. Leur plaire, leur etre utile, se faire aimer et honorer d'eux, les
élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre
la vie agreable et douce: voilà les devoirs des femmes dans tous les temps,
et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu'on ne remontera
pas à ce principe, on s'écartera du but, et tous les préceptes qu'on leur
donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le notre.
Guy de Maupassant
Au soleil* voyages;
Collection Nationale des
Grands auteurs de la nouvelle librairie de France,
C'est le midi du désert, le midi épandu sur la mer de sable immobile et
illimitée, qui m'a fait quitter les *bords fleuris* de la Seine chantés par
Mme Deshoulières, et les bains frais du matin, et l'ombre verte des bois
pour traverser les solitudes ardentes.
...
Flaubert disait quelquefois: "On peut se figurer le désert, les pyramides,
le Sphinx, avant de les avoir vus; mais ce qu'on ne s'imagine point, c'est
la tete d'un barbier turc accroupi devant sa porte".
...
Marseille au soleil transpire, comme une belle fille qui manquerait de
soins, car elle sent l'ail, la gueuse, et mille choses encore. Elle sent les
innommables nourritures que grignotent les Nègres, les Turcs, les Grecs, les
Italiens, les Maltais, les Espagnols, les Anglais, les Corses, et les
Marseillais aussi, pécaires, couchés, assis, roulés, vautrés sur les quais.
...
Puis on remonte sur le pont. Rien que la mer, la mer calme, sans un
frisson, et dorée par la lune. Le lourd bateau paraît glisser dessus,
laissant derrière lui un long sillage bouillonnant, où l'eau battue semble
du feu liquide.
Le ciel s'étale sur nos tetes, d'un noir bleuâtre, ensemencé d'astres que
voile par instants l'énorme panache de fumée vomie par la cheminée; et le
petit fanal en haut du mât a l'air d'une grosse étoile se promenant parmi
les astres. On n'entend rien que le ronflement de l'hélice dans les
profondeurs du navire. Qu'elles sont charmantes, les heures tranquilles du
soir sur le pont d'un bâtiment qui fuit!
Quel réveil! Une longue cote, et là-bas, en face, une tache blanche qui
grandit - Alger!
Féerie inespérée et qui ravit l'Esprit! Alger a passé mes attentes. Qu'elle
est jolie, la ville de neige sous l'éblouissante lumière! Une immense
terrasse longe le port, soutenue par des arcades élégantes. Au-dessus
s'élèvent de grands hotels Européens et le quartier Français, au-dessus
encore s'échelonne la ville arabe, amoncellement de petites maisons
blanches, bizarres, enchevetrées les unes dans les autres, séparées par des
rues qui ressembent à des souterrains clairs.
...
De la pointe de la jetée le coup d'oeil sur la ville est merveilleux. On
regarde, extasié, cette cascade éclatante de maisons dégringolant les unes
sur les autres du haut de la montagne jusqu'à la mer.
On dirait une écume de torrent, une écume d'une blancheur folle; et, de
place en place, comme un bouillonnement plus gros, une mosquée éclatante
luit sous le soleil.
...
Le train roule, avance; les plaines cultivées disparaissent; la terre
devient nue et rouge, la vraie terre d'Afrique. L'horizon s'élargit, un
horizon stérile et brulant. Nous suivons l'immense vallée du Chélif,
enfermée en des montagnes désolées, grises et brulées, sans un arbre, sans
une herbe. De place en place la ligne des monts s'abaisse, s'entre'ouvre
comme pour mieux montrer l'affreuse misère du sol dévoré par le soleil. Un
espace démesuré s'étale, tout plat, borné là-bas, par la ligne presque
invisible des hauteurs perdues dans une vapeur. Puis sur les cretes
incultes, parfois, de gros points blancs, tout ronds, apparaissent, comme
des oeufs énormes pondus là par des oiseaux géants. Ce sont des marabouts
élevés à la gloire d'Allah.
...
Saida! c'est une petite ville à la française qui ne semble habitée que par
des généraux.
...
La ville nouvelle est dans un fond, entourée de hauterus pelées. Une mince
rivière qu'on peut presque sauter à pieds joints, arrose les champs
alentours où poussent de belles vignes.
Vers le sud, les monts voisins ont l'aspect d'une muraille, ce sont les
derniers gradins conduisant aux hauts plateax.
...
Voici de vastes bâtiments, des cheminées de fabrique, une sorte de petite
ville abandonnée. Ce sont les magnifiques usines de la Compagnie
franco-algérienne. C'est là qu'on préparait l'alfa avant le massacre des
Espagnols. Ce lieu s'appelle Ain-el-Hadjar.
...
*Province d'Alger*
Les Algériens, les vrais habitants d'Alger ne connaissent guère de leur
pays que la plaine de la Mitidja. Ils vivent tranquilles dans une des plus
adorables villes du monde en déclarant que l'Arabe est un peuple
ingouvernable, bon à tuer ou à rejeter dans le désert.
La vie errante*, voyages;
Collection Nationale des
grands auteurs de la nouvelle librairie de France; Paris1999;
*Lassitude*
J'ai quitté Paris et meme la France, parce que la tour Eiffel finissait par
m'ennuyer trop.
Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout, faites
de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar
inévitable et torturant.
Ce n'est pas elle uniquement d'ailleurs qui m'a donné une irrésistible
envie de vivre seul pendant quelque temps, mais tout ce qu'on a fait autour
d'elle, dedans, dessus, aux environs.
Comment tous les journaux vraiment ont-ils osé nous parler d'architecture
nouvelle à propos de cette carcasse métalique, car l'architecture, le plus
incompris et le plus oublié des arts aujourd'hui, en est peut-etre aussi le
plus esthétique, le plus mystérieux et le plus nourri d'idées?
Il a eu ce privilège à travers les siècles de symboliser pour ainsi dire
chaque époque, de résumer par un très petit nombre de monuments typiques, la
manière de penser, de sentir et de rever d'une race et d'une civilisation.
Quelque temples et quelques églises, quelque palais et quelque châteaux
contiennent à peu près toute histoire de l'art à travers le monde, expriment
à nos yeux mieux que des livres, par l'harmonie des lignes et le charme de
l'ornementation, toute la grâce et la grandeur d'une époque.
...
C'est un problème résolu, dit-on. Soit, - mais il ne servait à rien! - et
je préfère alors à cette conception démodée de recommencer la naive
tentative de la tour Babel, celle qu'eurent, dès le XIIe siècle, les
architectes du campanile de Pise.
*La nuit*
Sortis du port de Cannes à trois heures du matin, nous avons pu recueillir
encore un reste des faibles brises que les golfes exhaltent vers la mer
pendant la nuit. Puis un léger souffle du large est venu, poussant le yacht
couvert de toile vers la cote italienne.
C'est un bateau de vingt tonneaux tout blanc, avec un imperceptible fil
doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc de cygne. Ses
voiles en toile fine et neuve, sous le soleil d'aout qui jette des flammes
sur l'eau, ont l'air d'ailes de soie argentée déployées dans le firmament
bleu. Ses trois focs s'envolent en avant, triangles légers qu'arrondit
l'haleine du vent, et la grande misaine est molle, sous la flèche aigue qui
dresse, à dix-huit mètres au-dessus du pont, sa pointe éclatante par le
ciel. Tout à l'arrière, la dernière voile, l'artimon, semble dormir.
Et tout le monde bientot sommeille sur le pont. C'est une après-midi d'été,
sur la Méditerranée. La dernière brise est tombée. Le ciel féroce emplit le
ciel et fait de la mer une plaque molle et bleuâtre, sans mouvement et sans
frisson, endormie aussi, sous un miroitant duvet de brume qui semble la
sueur de l'eau.
Malgré les tentes que j'ai fait établir pour me mettre à l'abri, la chaleur
est telle sous la toile que je descends au salon me jeter sur un divan.
Il fait toujours frais dans l'intérieur. Le bateau est profond, construit
pour naviguer dans les mers du Nord et supporter les gros temps. On peut
vivre, un peut à l'étroit, équipage et passagers, à six ou sept personnes
dans cette petite demeure flottante et on peut asseoir huit convives autour
de la table du salon.
...
Nous étions assez près des cotes, en face d'une ville, San-Remo, sans
espoir de l'atteindre. D'autres villages ou petites cités, s'étalant au pied
de la haute montagne grise, ressemblaient à des tas de linge blanc mis à
sécher sur les plages. Quelque brumes fumaient sur les pentes des Alpes,
effaçaient les vallées en rampant vers les sommets dont les cretes
dessinaient une immense ligne dentelée dans un ciel rose et lilas.
Et la nuit tomba sur nous, la montagne disparut, des feux s'allumèrent au
ras de l'eau tout le long de la grande cote.
...
Cette brume de la mer me caressait, comme un bonheur. Elle s'étandait sur
le ciel, et je regardait avec délices les étoiles enveloppées d'ouate, un
peu pâlies dans le firmament sombre et blanchâtre. Les cotes avaient disparu
derrière cette vapeur qui flottait sur l'eau et nimbait les astres.
*Stendhal* *Rome, Naple et Florence*, Ed. Gallimard, 1987,
*Ulm, 12 septembre 1816. - *Rien pour le coeur. Le vent du nord m'empeche
d'avoir du plaisir. La Foret-Noire, fort bien nommée, est triste et
imposante. La sombre verdure de ses sapins fait beau contraste avec la
blancheur éblouissante de la neige. Mais la campagne de Moscou m'a blasé sur
les plaisirs de la neige.
*Milan, 24 septembre 1816. - *J'arrive à sept heures du soir, harassé de
fatigue; je cours à la Scala. - Mon voyage est payé.
...Tout ce que l'imagination la plus orientale peut rever de plus singulier,
de plus frappant, de plus riche en beautés d'architecture, tout ce que l'on
peut se représenter en draperies brillantes, en personnages qui, non
seulement ont les habits, mais la physionomie, mais les gestes des pays où
se passe l'action, je l'ai vu ce soir.
*26 septembre 1816. - *J'ai retrouvé l'été; c'est le moment le plus touchant
de cette belle Italie. J'éprouve comme une sorte d'ivresse. Je suis allé à
Desio, jardin anglais délicieux, à dix mille au nord de Milan, au pied des
Alpes.
Je sors de la Scala. Ma foi, mon admiration ne tombe point. J'appelle la
Scala le premier théâtre du monde, parce que c'est lui qui fait avoir le
plus de plaisir par la musique. Il n'y a pas une lampe dans la salle; elle
n'est éclairée que par la lumière réfléchie par les décorations. Impossible
meme d'imaginer rien de plus grand, de plus magnifique, de plus imposant, de
plus neuf, que tout ce qui est architecture. Il y a eu ce soir onze
changements de décorations. Me voilà condamné à un dégout éternel pour nos
théâtres: c'est le véritable inconvénient d'un voyage en Italie. ...
*8 octobre 1816*. - Je ne sais pourquoi l'extreme beauté m'avait jeté hier
soir dans les idées métaphysique. Quel dommage que le *beau idéal*, dans la
forme des tetes, ne soit venu à la mode que depuis Raphael! La sensibilité
brulante de ce grand homme aurait su le marier à la nature. L'esprit à
pointes de nos artistes gens du monde est à mille lieues de cette tache. Du
moins, s'ils daignaient s'abaisser quelquefois à copier strictement la
nature, sans y rien ajouter de *roide, *fut-il emprunté du grec, ils
seraient sublimes *sans le savoir....*
*Antologia poeziei de la Rimbaud până azi,
BPT, 1974, Ed. Minerva, Bucureşti
*
Arthur Rimbaud
**
*Adormitul din şanţ*
E-o groapă de verdeaţă, în care cântă, lină,
O undă clătinată, cu fire de lumină
Şi horbodă-argintie prin foi şi rădăcini.
E un izvor de munte, prin lume, prin streini.
Cu ceafa-n iarba rece, voinicul doarme dus.
E un oştean. Visează, culcat cu faţa-n sus,
Cu capul gol. E palid în aşternutul verde.
Un nor frumos, departe, deasupra lui, se pierde.
Cu cizmele-n patlagini, surâde-n asfinţit,
Ca un copil cuminte, bolnav şi adormit.
Leagănă-l cald, Natură. Acoperă-l şi-l strânge.
I-i frig. El nici sulfina nu o mai simte. Drept,
Stă nemişcat pe spate, cu mâinile la piept.
În coaste are două rupturi adânci, de sânge.
*traducere de Tudor Arghezi*
**
*Catren*
**
Trandafiriu îţi plânge luceafăru-n ureche.
Alb, înfinitu-ţi cade de la grumaz la şale.
Roşcate perle marea ţi-a pus pe sâni, pereche.
Şi negru-ţi sângerează Bărbatul - rob, în poale.
*traducere de Petre Solomon*
*Stéphane
Mallarmé*
**
* Salut*
**
Neant, această spumă, vers
Virgin vestind doar cupa plină;
Aşa sirene în lumină
Se-afundă, multe-n salt invers.
Plutim, amici,o! stol divers,
Eu de pe-acum la pupă lină,
Voi însă prora ce dezbină
Furtuni şi ierni, din falnic mers;
Mă-ndeamnă-o limpede beţie
Să mă ridic cu semeţie
Şi să trimit salutul meu
Singurătate, steiuri, stele
Spre tot ce demn a fost mereu
De alba grijă-a pânzei mele.
*traducere de Al. Philippide*
*Oeuvres poétiques de Arthur Rimbaud*
* Une Saison en Enfer*
Collection nationale des Grands Auteurs de la Nouvelle Librairie de France
Ah! encore: je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles
et des enfants.
Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme.
Je n' en finirais pas de me revoir dans ce passé. Mais toujours seul; sans
famille; meme, quelle langue parlais-je? Je ne me vois jamais dans les
conseils du Christ; ni dans les conseils des Siegneurs, - représentants du
Christ.
Qu' étais-je au siècle dernier: je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de
vagabonds, plus de guerres vagues. La race inférieure a tout couvert - le
peuple, comme on dit, la raison; la nation et la science.
Oh! la science! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, - le
viatique, - on a la médecine et la philosophie, - les remèdes de bonnes
femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des
princes et les jeux qu'ils interdisaient! Géographie, cosmographie,
mécanique, chimie!
...
J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute
éternité.
...
Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un
sommeil bien ivre, sur la grève.
...
La dernière innocence et la dernière timidité.
La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes
frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance. Ni l'espoir d'echapper à la
vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force, et je loue Dieu
GUY DE MAUPASSANT,
Une Vie
L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le
ciel bas et chargé d'eau semblait crevé, se vidant sur la terre, la
délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient
pleines d'une chaleur lourde.
...
Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prete à
saisir tous les bonheurs de la vie dont elle revait depuis si longtemps,
craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'eclaircissait
pas; et pour la centième fois depuis le matin elle interrogeait l'horizon.
...
Depuis son entrée au Sacré-Coeur elle n'avait pas quitté Rouen, son
père ne permettant aucune distraction avant l'age fixé.
...
Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le
premier gros chagrin de son existence.
...
Le soleil s'était couché; des cloches sonnaient au loin. Dans un petit
village on alluma les lanternes; et le ciel aussi s'illumina d'un
fourmillement d'étoiles. Des maisons éclairées apparaissaient de place en
place, traversant les ténèbres d'un point de feu; et tout d'un coup
derrière une cote, à travers des branches de sapin, la lune,rouge,
énorme, et comme engourdie de sommeil, surgit.
...
Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se
répandaient. Un jasmin grimpé autour des fenetres d'en bas exhalait
continuellement son haleine pénétrante qui se melait à l'odeur plus
légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient, apportant les
saveurs fortes de l'air salin et de la sueur visqueuse des varechs.
La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer: et le repos de la
campagne la calma comme un bain frais.
...
Et elle resta longtemps, longtemps, à revasser ainsi, tandis que la lune,
achevant son voyage à travers le ciel, allait diparaître dans la mer.
L'air devenait plus frais. Vers l'orient, l'horizon pâlissait. Un coq
chanta dans la ferme droite; d'autres répondirent dans la ferme de gauche.
...
Un amour de la solitude l'envaissait dans la douceur de ce frais pays, et
dans le calme des horizons arrondis; et elle restait si longtemps assise sur
le sommet des collines que des petits lapins sauvages passaient en
bondissant à ses pieds.
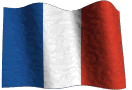

No comments:
Post a Comment